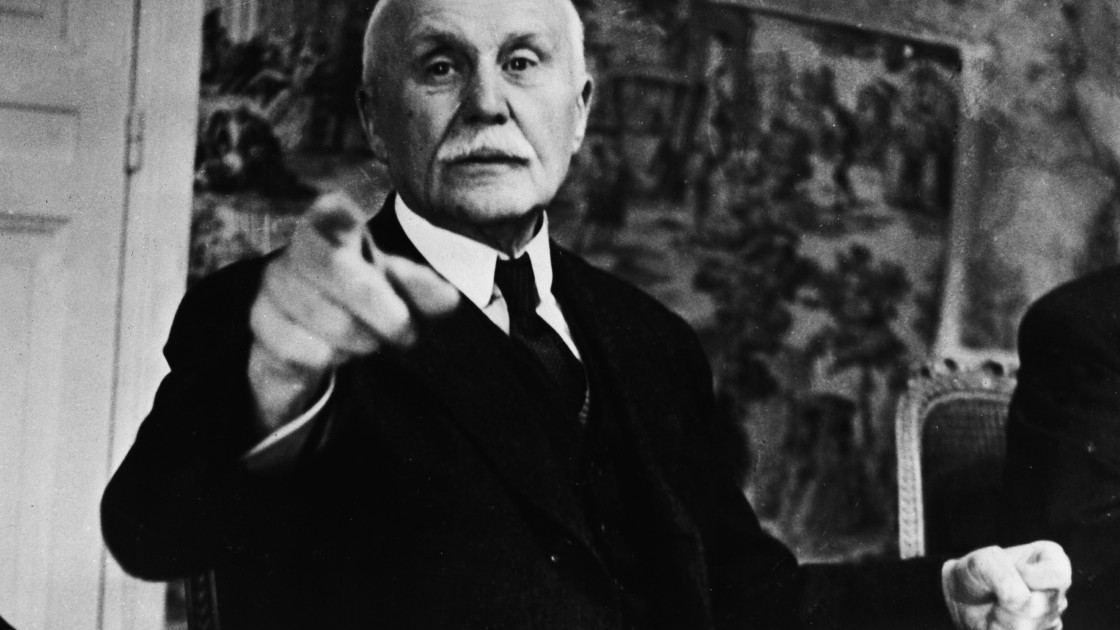« ECCE HOMO »
Madame, Monsieur,
Vous n’aimez pas le Maréchal Pétain. Vous considérez, au mieux, que lors de la première guerre mondiale il a pu faire illusion mais qu’au fond ce n’était pas le véritable vainqueur de Verdun, et s’il a alors manifesté quelques qualités, elles ont été effacées, Ô combien, par sa capitulation devant l’ennemi en 1940. Il s’est roulé dans la défaite. Qu’avait- on besoin d’une vieille gloire pour serrer la main d’Hitler sous les « sunlights » convoqué par Goebbels ? Il fallait laisser cela au maquignon Laval, sorte de Sancho-Panza, d’une fausse croisade, dans une France occupée, à bout de souffle, percluse d’humiliations, dont le dernier homme d’honneur avait ramassé l’épée brisée et brandissait à nouveau les couleurs sur les falaises de Douvres, seul contre tous, attendant l’heure de la revanche et de la reconquête. Et puis, sommet dans l’abjection, ce prétendu Maréchal, avait violé les lois sacrées de l’hospitalité, contribué activement à livrer à la barbarie nazie, de pauvres gens, avec femmes et enfants, venus par milliers de l’Est, fuyant les persécutions, au pays des Droits de l’Homme où ils éprouvèrent un faux sentiment de sécurité.
Confrontés à la soldatesque allemande, ils se seraient méfiés, mais abordés par la police française ils ont fait tout ce qu’elle leur a demandé, aveuglément, avec une entière confiance. Ils étaient soucieux d’agir dans la légalité. Songez à la Rafle du Vel d’Hiv. Pas un seul Allemand, que des Français !
Dans l’innommable, on a atteint des sommets ! C’est un crime contre l’humanité, à avoir honte d’être Français. Heureusement qu’un général De Gaulle a pris la relève avec brio et rendu sa fierté à un peuple qui ne méritait pas d’avoir été à ce point abaissé.
Vu ainsi, vous avez raison d’être indigné, de tourner la tête quand il est question de Pétain, d’avoir envie de cracher dans le Képi de cette gueule de traître. D’ailleurs, on vous le redit assez, soir et matin, dans les journaux, à la radio, sur toutes les chaînes, à tout propos, une armée de dames patronnesses se charge de vous le rappeler. Les anniversaires ne manquent pas, de l’institution de l’étoile jaune à la destruction du port de Marseille, des rafles à la découverte du Camp d’Auschwitz, de Pithiviers à Drancy. C’est à donner le tournis. Il y a les tribunes locales, mais aussi nationales, le Président de la République en personne dénonce à sons de trompe la complicité de l’État Français et donne des grands-croix en veux-tu en voilà aux redresseurs de torts.
La Shoah ? Ce fut la France, principalement. C’est à se demander si, sans sa participation, elle aurait bien eu lieu. Il en est question jusqu’à l’ONU où nos bas agissements locaux sont vilipendés sur la scène mondiale. Seul motif de soulagement, Pétain ne fut pas le seul félon. Il y en eut un autre, et pas des moindres, le Pape Pie XII en personne. Ah celui-là, il ne risquait rien à parler. Il jouissait d’une autorité morale absolue.
Qu’il ouvre la bouche, Hitler fermait son clapet. Les Juifs aussitôt coulaient des jours tranquilles. Les nazis leur foutaient la paix. Impardonnable ce silence d’un Pontife, très au courant, qui savait tout et n’a pas moufeté. Rolf Hochhuth, avec sa pièce Le Vicaire, interprétée dans le monde entier avec succès, lui a réglé son compte. Il ne s’en est pas relevé, comme Pétain avec La France de Vichy, de l’américano-irlandais, O Paxton, et le tout dernier mis sur orbite, Laurent Joly et sa Rafle du Vel d’Hiv. Pourtant la réalité n’est pas aussi manichéenne qu’il y paraît. Il faut aller au-delà des apparences et de ce que nous serinent les médias. Croyez bien que je ne vous condamne pas, à l’image de Celui qui disait : « Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu’ils font. »
Si l’histoire m’intéresse depuis toujours je me suis d’abord consacré à la défense des créateurs, dont je compte plusieurs dans ma famille, au sein de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, fondée au XVIII ème siècle par Beaumarchais, modèle des 220 qui ont essaimé dans plus de 130 pays. Dans le souci de mieux défendre leur cause, j’ai entrepris en plusieurs ouvrages d’en révéler l’histoire de la condition, des Grecs anciens à nos jours. Mon regard sur la société française a changé à partir du moment où j’ai découvert aux Archives Nationales, les 2 500 dossiers de la Commission Nationale d’Épuration créée par le général De Gaulle le 30 mai 1945, afin de juger en dernier ressort. Alors les écailles me sont tombées des yeux et j’ai pris conscience de l’ampleur de la désinformation entretenue par la nomenclatura sur la période de l’Occupation.
C’est ainsi que j’ai entrepris de contribuer à la réhabilitation du Maréchal Pétain dont j’ai découvert l’héroïcités des vertus, l’ampleur du sacrifice consenti et la contribution colossale à la protection de la population, la préservation des ressources et à la victoire anticipée des Alliés. « Le wagon de Montoire nous sauvera », avait-il dit, dans une de ces formules ramassées qui lui avait valu le qualificatif de : « Pétain le sec. » De fait, grâce à l’armistice, et de façon vraiment providentielle, l’Empire échappa à l’occupation par les troupes de l’Axe, et le Maréchal, en stratège consommé, disposa là d’un joker inespéré pour lequel il a avalé de gigantesques couleuvres, attendant l’heure de le jouer, tout en tentant de garder l’unité du pays et d’établir à cette fin une concertation avec un général De Gaulle jouant une carte essentiellement personnelle, au risque de lancer et d’attiser la guerre civile.
J’ai alors appris que Philippe Pétain, fils de paysan, orphelin à 1 ans, élevé par un oncle curé, aspirant à devenir prêtre, rallié par patriotisme au service de l’armée à la suite de la défaite de 1870, simple, proche de ses hommes, partageant leur vie, amoureux de la terre de France, ne cherchant pas à faire carrière, plein de bon sens, ennemi de la politicaillerie, refusant de serrer la main du général André, ministre de la Guerre, à l’origine de « l’affaire des fiches », ce qui, avec son franc-parler, n’arrangea pas sa carrière. A l’issue de grandes manœuvres spectaculaires où le haut-commandement avait confondu une contre-offensive avec un défilé du 14 juillet, il s’était exclamé, sans précaution oratoire : « Voilà exactement ce qu’il ne faut pas faire ! » Arrivé à la guerre de 14, en fin de carrière, au grade de colonel seulement, il répondit à une dame bourgeoise, étonnée de son peu d’avancement : « Madame, vous oubliez ma religion ». De fait, sommé par ses supérieurs de dénoncer les officiers allant à la messe, il avait répondu : « Je ne saurais vous le dire car je suis au premier rang et je n’ai pas coutume de me retourner pour regarder derrière moi pendant l’Office ». Joffre le distingua au moment de l’affaire de Charleroi où il avait été le seul à retraiter en bon ordre avec tout son matériel. Promu enfin général, il fit coudre, sur son nouvel uniforme, les étoiles de celui du général de Sonis. Ce dernier, entraîné dans la franc-maçonnerie par des amis, dans l’élan de la Révolution de 1848, en était sorti avec fracas lorsqu’il avait compris son effet destructeur des fondements de toute société.
Nommé en catastrophe à Verdun, la presse n’avait aucune photo de lui à publier, tant il était ennemi de toute publicité et adepte de la discrétion. Le Père de Foucauld, de sa promotion à Saint-Cyr, dit de celui dans les veines duquel coulait le sang de Benoît-Joseph Labre, le plus humble des saints : « C’est un brave garçon que tout le monde aimait ». Avec l’aménagement de « La voie sacrée » il révéla alors d’exceptionnelles qualités de logisticien, l’art de préserver ses troupes des massacres inutiles, à la mode, le sens de la manœuvre. Pionnier de l’utilisation combinée de l’artillerie, des chars et de l’aviation, il mena ses troupes à la victoire, donnant aux Allemands une cuisante leçon dont ils sauront tirer, en 1940, tout le parti que l’on sait. Quand, lassés de servir de chair à canon, près de deux millions de soldats, en 1917, se mutinèrent, en un temp record il sut leur parler, les remit sous les armes et les changea en lions qui enfoncèrent les lignes ennemies. A la sonnerie de l’armistice, il versa des larmes de sang d’être arrêté en plein élan et de ne pas pouvoir faire rentrer dans la tête du peuple allemand, dont pas un pouce du territoire avait été occupé, la conviction qu’il avait été bel et bien défait.
Clemenceau, franc-maçon, avait refusé, en 1916, la main tendue par le nouvel empereur d’Autriche, le bienheureux Charles I er, prêt à signer une paix séparée avec la France, ce qui aurait précipité la fin de la guerre, car il voulait l’élimination à toute force du dernier État officiellement chrétien, et contribué ainsi à répandre un flot de sang. Tardivement, il déclara que le sang avait déjà assez coulé, soutenu en cela par un maréchal Foch qui ne voyait pas d’un très bon œil Pétain sur le point de couper sa route sur les chemins de la gloire. Personnage clé de l’Empire Britannique, Lord Gurzon déclara, le 2 décembre 1918 : « Désormais la France est le premier ennemi de l’Empire britannique ». Phrase prémonitoire annonçant Mers el-Kébir. Mais ceci est une autre affaire.
Dans l’entre-deux guerres, le Maréchal jouit d’une popularité mondiale qui lui valut d’être accueilli en triomphateur aux Etats-Unis comme à la chambre par l’ensemble des députés debout, communistes compris, lorsqu’il devint un éphémère ministre de la Guerre.
Tôt il réalise qu’avec l’Allemagne, « ce n’est pas fini ». Il dénonce une démobilisation trop rapide et ne cesse d’appeler à la vigilance, sans être écouté. Ministre de la guerre du gouvernement Doumergue, il met fin aux discussions utopiques d’Aristide Briand, à Genève, et tente de reconstruire l’armée. Il met en garde contre le danger de la frontière Nord laissée à découvert et exposée à la pénétration de forces ennemies mécanisées, couplées avec un appui massif de l’aviation. De 1918 à 1932, cent milliards de francs ont été consacrés à l’entretien
des forces militaires et 4% au remplacement du matériel usagé, et pour l’essentiel aux fortifications de l’Est. Il plaide pour le détournement d’une partie des fonds destinés à la Ligne Maginot et son affectation prioritaire à la constitution d’unités mécanisées et au développement de l’aviation qui peut changer la donne sur le champ de bataille, largement mais en vain. Il s’inquiète de la décomposition de l’enseignement, fer de lance de la résistance morale d’un pays. Au Congrès des instituteurs syndiqués, à Lille, en juin 1936, le mot d’ordre était : « Mieux vaut la servitude que la guerre ». Même inquiétude, à l’image de Jean Fabry, ministre de la Guerre, face à l’inconséquence du Front Populaire, qui déclare : « Souffler la guerre à toutes les frontières et, en même temps vider les garnisons et arrêter le travail dans toutes les usines d’armement ».
Il dénonce l’insuffisance du travail en France quand il est porté à son maximum en Allemagne et le retard pris sur l’outillage. En 1935, il a fallu un an pour produire 35 chars SOMUA. En 1937, faute de matériel, les manœuvres chars-aviation sont annulées. Quarante-trois gouvernements de la III ème République se succèdent en vingt ans. Le 7 mars 1936, l’occupation de la Rhénanie signe la fin de l’entente avec l’Italie et entraîne un doublement des frontières à protéger. Le Populaire, organe du parti socialiste, proclame : « Pas un homme, pas un centime ! », et prône la démilitarisation de la frontière, c’est-à-dire l’évacuation de la Ligne Maginot. Son directeur, qui n’est autre que Léon Blum, fait voter le 7 septembre 1936 un plan d’armement de 14 milliards.
« Hélas, observe Jean Fabry, l’ampleur de ce plan n’avait d’égale que l’ampleur des grèves déchaînées dans le même moment. » Chute du rendement de 40 à 60% quand en Allemagne la production augmente de 177% et 277% dans l’automobile. La nationalisation des usines d’aviation conduit à la désorganisation de la construction aéronautique. Le 15 octobre 1936, la Belgique, inquiète de voir le rôle des communistes dans le Front Populaire, dénonce son alliance avec la France, empêchant le prolongement de la ligne Maginot qui était prévu le long de la Meuse. Quand Blum part, les caisses sont vides : il reste de quoi subvenir 2 heures au train de l’État. Le 21 août 1938, Daladier tente de redresser la barre et déclare à la radio qu’il faut « revenir sur la loi des quarante heures, faire beaucoup d’heures supplémentaires, les faire sans formalités, ni hauts salaires qui le rendissent impossible.
Remettons la France au travail ». Frossard et Ramadier donnent leur démission devant cette « insulte à la classe ouvrière. » Si le 30 novembre 1938 il brise la grève générale, le coup d’arrêt à la déliquescence du pays arrive trop tard. La France entre dans la guerre à la remorque de l’Angleterre, sans préparation ni doctrine.
Face à la percée subite de l’ennemi, Paul Reynaud, Président du Conseil, rappelle en catastrophe le Maréchal Pétain de l’ambassade à Madrid où Léon Blum l’avait propulsé, pour se faire pardonner d’avoir aidé les Républicains en douce, et éviter que l’Espagne ne devienne une menace pour la France. Franco l’adjura : « N’y allez pas ! ne donnez pas votre nom à ce que d’autres ont perdu ». À quoi il répondit : « Mon pays a été battu et ils me demandent de revenir faire la paix et signer l’armistice… C’est le travail de trente années de marxisme. Ils me rappellent pour prendre en main la nation ». Face à la défaite, isolé, ne voulant pas assumer la responsabilité de demander l’armistice et espérant revenir à la première occasion, Paul Reynaud recommande au président Lebrun d’appeler le Maréchal comme successeur, ce qu’il fait. Pétain se dévoue et accepte d’assurer le gouvernement de la France en plein effondrement. Quel cadeau ! Porté sur le pavois, le 10 juillet 1940, au Casino de Vichy, moins une poignée d’élus habitués à voter non à toute proposition ou trouvant que le Maréchal ne dispose pas d’assez de pouvoirs, le nouveau chef de l’État se met à l’œuvre. Au général Héring qui, le lendemain, vient le féliciter, il répond tout de go : « A titre de martyr seulement ».
L’assemblée du Front populaire s’en était prise au travail, à la famille et à la Patrie. Sur les valeurs qu’elle avait combattues, elle lui demande, face à l’échec complet, de rédiger un projet de nouvelle constitution. La Déclaration des Droits de l’Homme, prise isolément, avait le grand défaut d’exacerber l’individualisme, et de ne pas mettre l’accent sur les devoirs du citoyen, incité à exiger toujours plus, à titre personnel, sans rien donner en retour. Il s’attache à la rédaction à quatre mains, avec le Pape Pie XII, d’un complément nécessaire. Ce sont les 16 principes de la communauté, aussitôt affichés dans les écoles et les mairies.
A l’abri au sein de la zone libre de toute occupation qu’il était parvenu à arracher au vainqueur, il s’attache à assurer la réunion des familles, le rétablissement des communications, du ravitaillement, la sauvegarde des mines et ressources de toutes sortes, du parc industriel, de l’administration, et lance une politique culturelle très active, toutes disciplines confondues, souvent bénéfique en dépit de la censure. Par la création des Chantiers de jeunesse, il fait échapper la jeune génération à la désespérance et la forme afin qu’elle soit apte à reprendre le combat quand les conditions de cette reprise seront réunies. Il s’active sur tous les fronts et multiplie les nouvelles contributions : adoption de la Charte du travail (salaire minimum vital, comités d’entreprise, inspection du travail, cantines d’écoles et d’entreprises, médecine du travail, retraite des vieux travailleurs – si souvent annoncée et jamais mise en œuvre – création du Secours National), lutte contre l’alcoolisme et le proxénétisme, aide aux prisonniers, rétablissement du statut des prisonniers politiques, supprimé par Daladier, sauvegarde de la grande majorité des juifs français, limitation du STO, indépendance de la Flotte et de l’Empire, préparation des « Trente glorieuses» par la réorganisation de l’économie, préservation de Paris, organisation de la régionalisation, relance de la démographie, tout en ne cessant de tendre la main aux hommes de Londres et d’Alger, afin d’éviter une fracture entre compatriotes. Le 24 juillet 1944, Otto Abetz, ambassadeur d’Allemagne à Paris, lui dira : « Vous avez sauvé de la mort des millions de Français ».
Mais, me dira-t-on, vous oubliez le Statuts des Juifs. A lui seul, il vaut condamnation sans appel du Maréchal et de sa politique. Il a fallu les travaux d’un américain, O Paxton, pour montrer que les Allemands ne le demandaient pas. En l’adoptant le Maréchal se serait déshonoré en le leur offrant. Depuis, sa réputation fait l’objet d’un piétinement général, sans la moindre réflexion. Nul ne se demande si une aussi noble figure n’a pas agi comme elle l’a fait pour contrer les Allemands. Or c’est bel et bien ce qui s’est passé. N’en déplaise à M. O Paxton, les Allemands ont imposé l’application des Lois de Nuremberg en Alsace-Lorraine, dès leur occupation, en dépit des protestations véhémentes du Maréchal à la Commission d’Armistice. Or le général La Laurencie, Délégué général du gouvernement en zone occupée, alerte Vichy de la volonté des Allemands de généraliser leur application à l’ensemble de la zone occupée. S’engage alors une course de vitesse entre le gouvernement et l’occupant pour, par l’adoption d’un statut des juifs comportant des restrictions a minima, couper l’herbe sous les pieds de l’occupant et l’empêcher de légiférer avec sévérité. Otto Abetz, ne s’y trompe pas, qui écrit : « La législation de Vichy fait pendant aux décrets allemands uniquement pouren adoucir les dispositions ».
Voilà à quoi conduit la diabolisation du Maréchal, la volonté systématique de ne voir en lui que des sentiments bas. Loin d’être la marque d’une faiblesse coupable, de la veulerie du vaincu, ce statut signe l’habileté du Maréchal, sa capacité à déjouer les mauvais coups des Allemands en les prenant à leur propre piège. Que de contresens ! Il en ira ainsi pour la Rafle du Vel d’Hiv. Bien sûr, Pétain et Laval commenceront par refuser le concours de la police française, mais c’était aller contre l’application de la Convention de La Haye dont les deux pays étaient membres, et de la lettre de l’armistice. En cas de refus de Vichy, l’armistice était dénoncé, la zone libre et l’Afrique du Nord étaient envahis et tous les Juifs déportés et éliminés. Voilà le genre de chantage effroyable auquel le Maréchal était en permanence exposé.
Jamais Pétain ne se départira d’un ton d’une grande dignité à l’égard de l’Occupant. Lors de ses entretiens avec Renthe-Fink, diplomate-geôlier placé par Hitler à ses côtés, le commandant Tracou, son directeur de Cabinet, admirera ses qualités diplomatiques : « prodigieuse faculté d’adaptation aux circonstances, maîtrise surhumaine des nerfs, esprit d’à-propos, force de silence, le tout accompagné d’une bonne grâce souveraine et d’une courtoisie vraiment Louis Quatorzième. » A Montoire, à Saint Florentin, il fera preuve de fermeté vis-à-vis des nazis, tout comme lorsqu’il refusera d’entériner le protocole d’accord dit « de Paris », arraché à Darlan par Hitler ou la dénaturalisation des juifs naturalisés depuis 1927, qui aurait eu pour effet de les livrer sur le champ à une mort certaine. Le 7 avril 1941, dans une allocution radiodiffusée, il parviendra à dire, bravant la censure : « L’honneur nous commande de ne rien entreprendre contre d’anciens alliés ». Au moment du débarquement des Américains en Afrique du Nord – tremplin des futurs débarquements en Italie et en Provence – libre, grâce à lui, de toute présence ennemie, les Allemands le pressèrent à nouveau de s’allier à eux, à la vie, à la mort. Il s’y opposa énergiquement, autorisa Noguès et Darlan à traiter avec les Alliés et empêcha que la flotte ne tombât entre les mains de l’Axe. Si l’opinion bascula alors en faveur des Anglo-saxons, l’Angleterre porte une lourde responsabilité dans l’hostilité persistante manifestée contre elle par certains – Maurras, Jean d’Agraives – et qui leur sera comptée à crime à la Libération.
Le général De Gaulle trouvera dans l’armée d’Afrique, magnifiquement reconstituée par Weygand, l’épée de connétable qui lui manquait et dont, par ressentiment, il ne tirera pas, avec le reste de la Flotte, tout le parti qu’elle lui offrait, tout en la mettant dans la balance au service de la France, au moment des négociations de paix. Enfin, le 4 décembre 1943, Hitler, par la plume de Ribbentrop, décernera au chef de l’État-Français, après sa tentative de remise de son pouvoir constituant à l’Assemblée nationale, un éclatant brevet de résistance. Qu’on en juge : « Si on jette un regard sur les trois dernières années des rapports franco-allemands, il reste incontestable que les mesures que vous avez prises en votre qualité de Chef de l’État ont eu malheureusement trop souvent le résultat de rendre plus difficile la collaboration qui pourtant était poursuivie par le gouvernement français. Cette lutte constante a eu pour conséquence de rendre impossible par votre résistance permanente la nomination aux postes les plus importants du Gouvernement français et de l’administration des hommes dont l’attitude loyale aurait assuré l’exécution d’une politique raisonnable de consolidation
intérieure de la France ».
Au risque de susciter l’incrédulité de ceux qui voient en lui un croquemitaine, le Maréchal se soucia de venir en aide aux déportés dont on n’avait plus de nouvelles. Ainsi chargea-il François Lehideux, directeur du Comité d’organisation de l’automobile, de profiter d’un voyage à Berlin où il devait rencontrer de hautes personnalités, pour s’informer sur la destination des juifs afin que la France pût leur livrer des denrées alimentaires. Lehideux n’obtiendra aucune information exploitable. Selon Jean Borotra, tout le monde était persuadé, en 1942, quand les déportations commencèrent, que les Juifs étaient emmenés dans des camps de travail. Lui-même pensa qu’il en serait ainsi quand il fut déporté à Sachsenhausen, le 30 novembre 1942 et qu’il vit sur le portail du camp : « Arbeit macht frei ». Née d’une famille juive d’Alsace-Lorraine, l’historienne Annie Kriegel observera : « Il y a une jeune école historique qui veut mener une sorte de guerre privée et qualifiée d’héroïque contre le gouvernement de Vichy. Il me paraît absurde de renverser les choses au point de dire que non seulement le gouvernement a été complice mais qu’il a pris l’initiative d’une entreprise de répression ». Elle fait écho à Simone Weil, la philosophe attirée par le christianisme, qui de New-York écrivait au professeur Jean Wahl, en novembre 1942 : « Je n’aime pas beaucoup entendre des gens parfaitement confortables ici, traiter de lâches et de traîtres ceux qui en. France se débrouillent comme ils peuvent dans une situation terrible… Je crois que Pétain a fait tout ce que la situation générale et son propre état physique lui permettaient de faire pour limiter les dégâts ». Néanmoins, l’activisme de cette école va entraîner l’adhésion des pouvoirs publics à cette thèse discutée, avec une sévérité croissante.
Affublé de tous les crimes, Pétain est condamné à mort par un Tribunal révolutionnaire conçu à cet effet et non pour juger, alors qu’il a tenu à revenir en France pour rendre compte de ses actes et prendre sur lui la responsabilité des agissements reprochés à ceux qui l’ont rallié. Si l’on suit le général De Gaulle, l’Armistice équivalant à une franche collaboration, et donc à la trahison de la patrie, la France entière a collaboré. Le président Lebrun a été un acteur décisif de la collaboration en demandant au Maréchal Pétain de former le nouveau gouvernement, à la suggestion de Paul Reynaud, sachant qu’il demanderait un Armistice. Le 6 juin 1940, ce dernier, grand procureur du Maréchal, avait battu sa coulpe, mais un peu tard : « Reconnaissons nos torts. Dans leurs gouvernements successifs et dans leur esprit public, les démocrates ont depuis longtemps manqué de clairvoyance et d’audace.
L’idée de patrie, l’idée de valeur militaire ont été trop longtemps négligées ». La quasi- totalité des députés et sénateurs a collaboré, en votant, le 9 juillet, le principe de la réunion, le lendemain, des deux chambres, en vue de transférer au Maréchal le pouvoir constituant ; les États-Unis et l’U.R.S.S. ont collaboré, en reconnaissant le gouvernement du Maréchal et en dépêchant un ambassadeur à Vichy. L’Armistice a été plébiscité par la France entière et aucun parlementaire ne l’a remis en cause le 10 juillet. Au moment du procès du Maréchal, Mauriac aura cet aveu dans Le Figaro : « Ne reculons pas devant cette pensée qu’une part de nous-mêmes fût peut-être complice, à certaines heures, de ce vieillard foudroyé ». Et si le général a déclaré à la presse le 10 mars 1952 : « Chaque Français fut, est ou sera Gaulliste. Je ne jurerai pas qu’à quelque moment, malheureusement trop tard ! le maréchal Pétain ne l’ait pas été quelque peu ». Cette assertion ne vaudrait-elle également à l’égard du Maréchal ?
Or, que se serait-il passé si le Maréchal avait refusé de devenir chef de l’État ? Gibraltar occupé dès juillet 1940 avec, dans la foulée, toute l’Afrique du Nord. Près de 1,5 millions de prisonniers, avec à la clé la dénatalité et l’effondrement économique du pays.
Saisie illimitée du cheptel, des machines-outils, des œuvres d’art, STO sans frein, extermination de tous les juifs de métropole et d’Afrique du Nord, débarquement retardé de plusieurs années. Que sont les erreurs, les faiblesses d’un grand vieillard, peu à peuvolontairement coupé de ses fidèles soutiens pour mieux le manipuler, soumis chaque jour à d’odieux chantages, au regard de ce qu’il a sauvé en bernant Hitler par l’armistice et sauvant tout ce qu’il a sauvé ? Le colonel Rémy, résistant de la première heure, fidèle compagnon du général De Gaulle, finit par le comprendre et dire que son nom devrait figurer en lettres d’or au Panthéon de l’Histoire de France. Il en allait à peu près ainsi jusqu’à ce qu’éclate la bombe signée O Paxton : La France de Vichy. Le voici mis au pilori comme antisémite et collaborateur actif de la réalisation de la Shoah. Sa condamnation paraît désormais parfaite.
Sollicité pour lui porter le coup de grâce, le président Jacques Chirac saute le pas. Là où ses prédécesseurs ménageaient l’État-Français, il cautionne sa mise en cause, la rend officielle, se
couvre de cendres, se mue en flagellant et transmet son fouet à ses successeurs. Après-guerre, le commandant Tracou, ancien aide-de camp du Maréchal, publia un bel ouvrage à l’égard de
celui qu’il avait servi et observé de près : Le Maréchal aux liens. De fait, à l’exemple du « Fils de l’Homme », portant les péchés du monde, le Maréchal se réfugia dans le silence devant ses juges, au moment de son procès. Que dire à ses accusateurs, tant la distance était grande entre la représentation qu’ils en avaient, et la réalité de sa personne. Le général De Gaulle, en génie politique consommé, au point d’en remontrer au prince Sihanouk, a dit tout et son contraire. A François Lehideux, après avoir démoli le Maréchal, il finit par concéder :« Le Maréchal Pétain était un Monsieur trop grand pour eux, les Français ne le méritaient pas ». En quoi il exprimait la stricte vérité. Beaucoup de ses accusateurs prêtent au Maréchal leurs propres sentiments. Comme ils ont le cœur petit ils sont dans l’incapacité de mesurer l’ampleur de sa générosité et de son esprit de sacrifice. Là où il y a sacrifice, ils ne voient qu’ambition, là où il y a courage, ils soupçonnent la lâcheté, là où il y a vision pénétrante ils dénoncent l’aveuglement. Quoi qu’il fasse, quoi qu’il dise, tout est tiré vers le bas.
Face à la confrontation Pétain-De Gaulle, nous faisons nôtres ces paroles de Jean Fabry : « A quoi bon discuter qui des deux a eu raison d’agir comme il l’a fait ? A quoi bon discuter qui des deux a le mieux servi la France ? Vaines querelles, disputes fratricides, qui nous ont coûté cher ! Ce qui restera éternellement regrettable, c’est que tant de prestige, d’autorité et sagesse d’un côté, et tant d’esprit d’entreprise, d’ambition généreuse de l’autre, n’aient pu se souder étroitement dans une même volonté pour un même effort : c’est que l’homme de Verdun et l’homme de Londres n’aient pu s’épauler l’un l’autre. Au contraire, le malheur a été qu’on en vint à ne pouvoir approuver l’un sans condamner l’autre, au point que chacun courait le risque d’être accusé de trahison s’il n’accusait l’autre de trahir. Il n’est rien sorti de bon de cette division des Français, accablés par le malheur, ravagés par la haine. Tant et si bien qu’au soir d’une libération exaltante, ils n’ont pu éviter de la tremper dans un bain de sang, où du sang français le plus pur fut mélangé misérablement avec celui des véritables traîtres, avec celui des profiteurs imprudents, avec celui des dénonciateurs criminels ». Ce n’était pas faute, pour le Maréchal, d’avoir cherché avec obstination, une forme de concertation avec l’homme de Londres, drapé dans sa solitude, lancé « comme une savonnette » par Churchill, avec le concours de l’agence de communication Richmond et Temple.
Voici donc le résumé de mon combat. Particulièrement sensible au sort de nos compatriotes juifs durant cette période, lorsque je publiai Je brûlerai ma gloire, j’éprouvai moralement le besoin, par souci de vérité, d’en dédicacer le premier exemplaire à Arno Klarsfeld, avec lequel j’avais entretenu de bonnes relations à la Société des Auteurs, et d’aller le lui remettre en main propre, au cabinet de son père, accompagné d’une lettre où je me tenais à leur disposition pour parler avec eux de ce que j’avais été conduit à écrire sur la condition des Juifs, lors de la dernière guerre. Il était à New-York. Je confiai donc le tout à sa mère, Mme Beate Klarsfeld, sur le point de fermer les locaux où ils œuvraient. Dans la suite je ne reçus aucun message. Leur silence me pesa. Devenu le lointain successeur de Maître Isorni, je pris le même chemin, cette fois avec en main une lettre que je comptais remettre à l’intention du Père, Serge, infatigable pourfendeur du Maréchal, poseur de stèles assassines à son endroit, un peu partout, particulièrement à Vichy, face à l’Hôtel du Parc ou au Monument aux Morts, qui me perçaient le cœur. Dans la cour de l’immeuble, j’aperçus le patriarche à son bureau. Je sonnai. Avec émotion je reconnus le visage et la silhouette de Madame Beate Klarsfeld. Une nouvelle fois je tentais donc d’entrer en dialogue avec le champion de la cause des déportés. Je lui remis la lettre à l’intention de son époux, tout en lui disant que j’aimerais lui dire un mot. Munie de mon enveloppe elle disparut dans le bureau voisin. Je l’entendis parlementer, tenter de m’obtenir un éclair d’entretien. Serge Klarsfeld argumentait. Sa voix me parvint : « Président de l’ADMP…» Je fis un pas et passai d’abord la tête par l’embrasure de la porte, puis le buste, enfin le corps tout entier. « Pardonnez-moi, Maître, je ne veux surtout pas vous déranger maintenant. Je viens seulement prendre rendez-vous, vous proposer de déjeuner ensemble. Ce peut-être dans un mois, dans deux mois, dès que vous pourrez ». A son bureau je le vis remuer des papiers, comme s’il se noyait, répétant : « Je n’ai pas le temps, je n’ai pas le temps, je suis très occupé ». Puis il se leva, vint à moi sans me regarder, me prit par le bras et m’entraîna doucement mais fermement vers la sortie. Je lui soufflai alors : « Seriez-vous d’accord pour permettre à la dépouille du Maréchal de reposer à Douaumont ? » Il me lâcha au visage. : « Cela adviendra peut-être, dans quelques vingtaines d’années… », et referma l’huis sur ma personne, avec un soupir de soulagement. Je ne m’étais jamais départi d’une attitude et d’un ton empreints d’un grand respect, mais je sentis que, confronté à brûle pourpoint à la remise en cause de certains de ses propos entiers sur le Maréchal, il se montrait peu sûr de lui.
Peu de temps après je visionnai le documentaire suscité par Anne Sinclair sur La Rafle des Notables déclenchée en représailles d’attaques de résistants juifs dans la région parisienne, dont son grand-père, le marchand de tableaux Pierre Rosenberg, avait fait partie. J’avais acheté son livre. Il était émouvant de voir la petite fille se pencher sur ce qu’avait vécu son grand-père dans cette période dramatique. Le fils de Tristan-Bernard, Jean-Jacques, en avait été également la victime et j’avais lu, le cœur serré, son échange de correspondances avec les siens. Saisi à son domicile au petit matin par les Allemands, il n’avait pas eu le temps d’emporter ses lunettes. Il s’était habillé en vitesse avec un beau costume, manière d’afficher sa dignité face à la violence qui lui était faite. Puis il avait été conduit au Grand Manège de l’École militaire avant d’être transporté à Compiègne, au Camp de Royallieu. Là sa femme, soudoyant un gardien, était parvenue à lui faire tenir ses lunettes, roulées dans la page de garde de sa pièce Marie-Stuart, que le Président de la Société des Auteurs, Charles Méré, avait eu l’extrême délicatesse de faire publier aux frais de la Société, comme consolation à l’interdiction de la faire représenter, car il était juif. Les bâtiments où ils avaient été parqués, existaient encore. En cela l’émission me fascina, mais une expression du commentateur me fit dresser l’oreille : « Lorsque le Maréchal Pétain prit le pouvoir… » Le Maréchal ? Il était en Espagne, et c’est le gouvernement qui vint l’y chercher. Quant au pouvoir, il ne l’a pas pris, les derniers représentant du régime républicain finissant le lui avaient donné. Dans la panique générale, toutes les mains se tendaient vers lui « comme vers une bouée de sauvetage », selon l’expression du Président du Sénat, Jeanneney. Comme à chaque fois, dans ce genre d’émission, des propos tendancieux venaient jeter l’opprobre sur le comportement, les intentions de ceux qui, confrontés à la pression de l’ennemi, avaient tenté de s’opposer à eux et d’en entraver l’action. D’où ma décision d’envoyer un mot à Anne Sinclair, lui proposant de la rencontrer, adressé au domicile de Pierre Nora avec qui j’avais brièvement échangé peu auparavant. Deux mois plus tard, après mûre réflexion, elle m’a fait savoir que pour elle, l’Histoire avait tranché et qu’elle ne voyait pas d’intérêt à me recevoir.
Enfin je pris ma plus belle plume pour, dans le cadre de mes nouvelles fonctions, demander au Président Robert Badinter de bien vouloir me permettre de le rencontrer. Nous avions un ami commun, l’auteur dramatique Pierre Barillet, par le truchement duquel nous avions correspondu au fil des ans. Grâce à lui le Président du Conseil Constitutionnel était venu à la célébration que j’avais contribué à organiser dans les ors de l’hôtel Blémont, rue Ballu, à l’occasion de la célébration du centenaire de la Convention de Berne et il avait offert une magnifique réception aux membres du congrès, alors qu’il était chiche de la disposition des deniers de l’État.
En plusieurs occasions il s’était montré secourable et je lui gardai ma
reconnaissance pour l’aide qu’il m’avait spontanément apportée. Je pensais que si j’arrivais à m’entretenir en tête à tête avec lui j’aurais peut-être une chance de lui présenter le Maréchal sous un jour plus favorable que celui qui lui est ordinairement accordé, et de le gagner à l’idée d’autoriser le transfert de ses restes, à Douaumont, parmi ceux des soldats qu’il avait conduit
à la victoire, selon son vœu. Garde des Sceaux il avait décliné la demande de l’ADMP de rouvrir son procès, jugeant que désormais « l’Histoire jugerait ». Je l’avais également entendu dire à la Télévision que le Maréchal avait renoncé à se rendre à Alger car il ne supportait pas l’avion. En fait, il s’agissait là d’un prétexte pour lui de se débarrasser de ceux qui le pressaient de renoncer à l’engagement qu’il avait pris devant les Français, de demeurer avec eux dans les heures sombres. Dans la réalité il appréciait l’avion et avait conduit la guerre du Rif avec un avion personnel. Là encore, ma lettre se heurta à un profond silence. Je songeai alors à l’expérience rapportée par Fabre-Luce. Lors de sa visite du sanctuaire de Yad Vashem, à Jérusalem, il avait fait remarquer au gardien, un juif français laissé pour mort par les Allemands, après être passé devant un peloton d’exécution, que, proportionnellement, la France était le pays où ses coreligionnaires avaient été le moins maltraités, et s’était attiré cette réponse : « Nous avons trop souffert pour l’admettre ». Telle était peut-être la raison du silence suscité par mes propositions d’entretien, et du manque d’objectivité manifesté par des Israélites, pas tous, heureusement – je songe à l’historien François-Georges Dreyfus, au rabbin Henri Michel – dans leur jugement du Maréchal.
Madame, Monsieur, nous voici au terme de cette lettre. Avant de conclure, gardons à l’esprit les paroles du général De Gaulle au colonel Rémy, un soir de 1947, à l’issue d‘un dîner au Bois de Boulogne : « Rémy, souvenez-vous qu’il faut que la France ait toujours deux cordes à son arc. En juin 1940, il lui fallait la corde Pétain et la corde De Gaulle. Je ne comprendrai jamais pourquoi le Maréchal n’est pas parti à Alger au mois de novembre 1942.
Les Français d’Algérie l’eussent acclamé, les Américains l’eussent embrassé, les Anglais auraient suivi, et nous, mon pauvre Rémy, nous n’aurions pas pesé bien lourd dans la balance ! Le Maréchal serait rentré à Paris sur son cheval blanc ». Le 27 janvier dernier, nous avons en vain tenté de faire publier par l’AFP le communiqué suivant : « En ce jour anniversaire de la découverte du camp d’Auschwitz, l’Association pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain rappelle que le 27 janvier 2020, l’ONU a reconnu officiellement que le pape Pie XII, longtemps vilipendé, avait contribué à sauver 947 000 vies juives. Or, sous le gouvernement du Maréchal, les 440 000 juifs d’Afrique du Nord ont été sauvés ainsi que 75 % des 330 00 Juifs résidant en métropole, fait unique en Europe. Respectant la parole donnée en 1940 aux Français, le Maréchal a refusé de gagner Alger en 1942 pour continuer de protéger la population, juifs compris. Qui sait qu’il a permis de maintenir l’interdiction du port de l’étoile jaune en zone libre, même une fois occupée, et empêché la dénaturalisation des 50 000 juifs naturalisés selon la loi d’inspiration maçonnique du 10 août 1927, privilégiant l’intérêt international sur l’intérêt national, comme l’exigeaient les Allemands ?
Guy Raïssac, magistrat instructeur de son procès, observa vingt ans après : « Un pays ne peut sans dommage renier et flétrir l’un de ses rares grands hommes, fût-ce à l’heure de son déclin, sans courir le risque d’altérer sa propre substance ».
L’autorisation du transfert de la dépouille du Maréchal à Douaumont, selon son vœu, parmi les restes de ses soldats qu’il avait conduits à la victoire, serait une mesure de justice et d’apaisement dans une lutte franco- française qui n’a que trop duré alors que, comme l’a observé en son temps, s’adressant à la Haute-cour, Kenneth de Courcy, secrétaire du Parti Conservateur, soutien de Churchill : « Je ne crois pas que, dans toute l’Histoire, il y ait eu un pays qui ait été aussi complètement joué que les Allemands l’ont été par les Français… Quel dommage qu’on ne réalise pas cela : Pétain sans De Gaulle et De Gaulle sans Pétain n’auraient jamais obtenu un résultat comparable à celui qu’ils ont obtenu ensemble ».
03 avril 2023
Jacques BONCOMPAIN
Président de l’Association pour Défendre la Mémoire du Maréchal Pétain